journal Le Ô – Quand René Gori prend les traits d’un doux dingue….
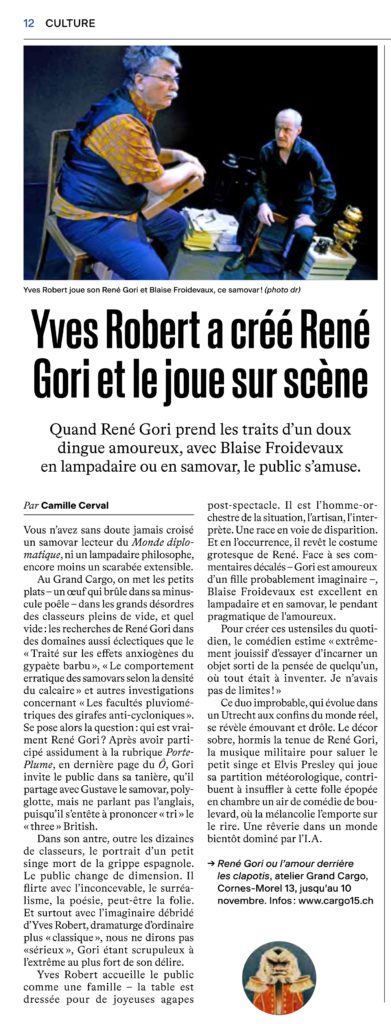
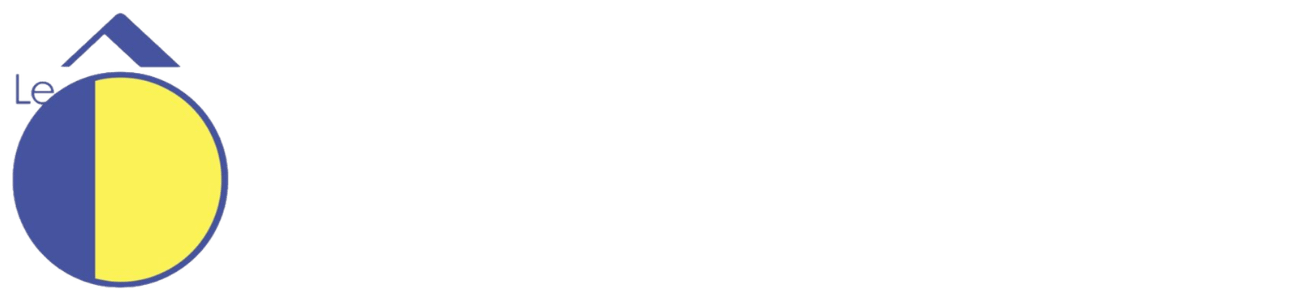
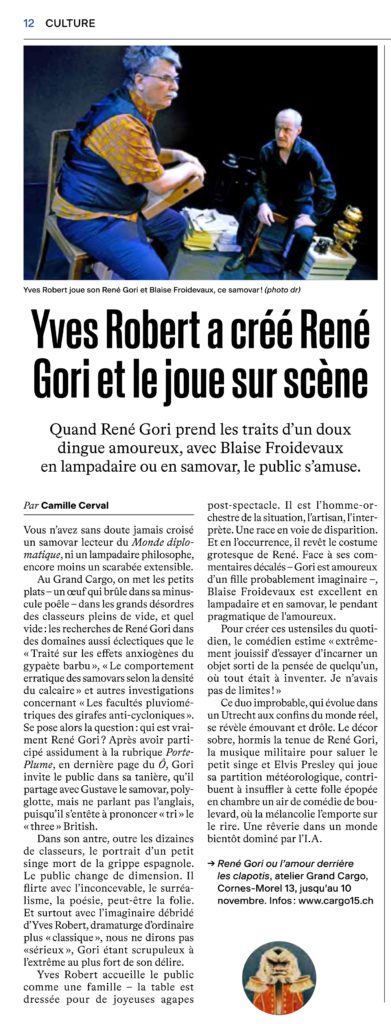
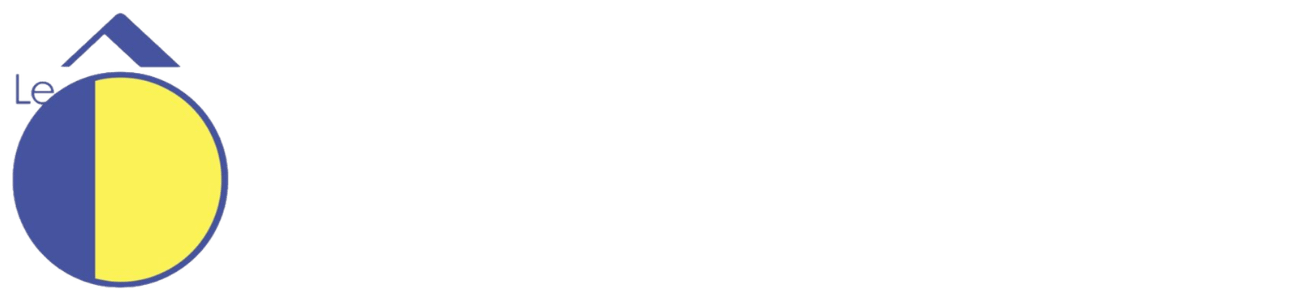
De toujours, l’écrivaine et journaliste Bernadette Richard se passionne pour l’atome, à son usage et ses conséquences. Née au début de la Guerre froide et du maccarthysme elle baigne, durant toute sa jeunesse, dans la propagande pro et antinucléaire et sous la menace d’une destruction totale de la planète en cas de guerre atomique.
Pour mémoire, son roman Dernier concert à Pripyat, publié aux Éditions L’Âge d’Homme peu avant la guerre d’Ukraine, se déroule dans la zone sinistrée de Tchernobyl. De sa plume, surgit à présent une pièce de théâtre écrite en 1995, pour les 50 ans d’Hiroshima. Elle n’a jamais été jouée. Cependant, à l’heure où Vladimir Poutine et quelques puissances possédant l’arme atomique, brandissent le péril nucléaire, elle est plus que jamais d’actualité. C’est pourquoi, ce soir et demain, Caroline Althaus, comédienne lausannoise et professeure au Théâtre Montreux Riviera, Emmanuel Moser comédien, directeur artistique de La Plage des Six Pompes et du Centre de Compétences et de Création Helvétique des Arts de la Rue, et Yves Robert metteur en scène, auteur de plus de 20 pièces de théâtre et de romans adaptés pour les planches, nous proposent une lecture-spectacle, « bien sentie », de ce texte.
Sous forme d’entretien, Hibakushas Oppenheimer nous rappelle non seulement les motifs fallacieux pour lesquels les villes de Nagasaki et Hiroshima furent détruites, mais également l’enfer vécu par les survivants. Deux Hibakushas, comme l’on nomme les rescapés de ce massacre, s’entretiennent avec le spectre de Robert Oppenheimer, père de la bombe atomique et scientifique de génie idéaliste et psychologiquement fragile. Opposant à la bombe thermonucléaire – Bombe H –, malmené par sa conscience et la chasse aux sorcières maccarthyste, il tente maladroitement de justifier sa découverte et ses dégâts irréversibles. Une réflexion sur une arme de destruction massive, sur la politique, sur la réécriture de l’Histoire et sur les manipulations dont les Êtres Humains sommes les victimes.
Dunia Miralles
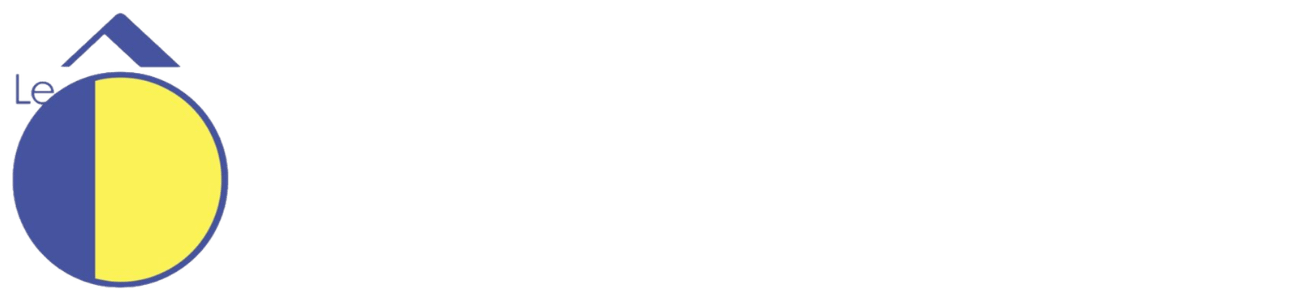
Explorer la mémoire équivaut parfois à ouvrir la boîte de Pandore. C’est ce à quoi s’est confronté le metteur en scène et écrivain Yves Robert au Grand Cargo, avec son spectacle Le Journal du silence, joué en juin. Sa pièce part en tournée, premier arrêt, ce soir et demain au Théâtre du Concert à Neuchâtel.
Nous sommes loin, ici, du savant travail des neurosciences. Et pourtant, l’écriture théâtrale est capable de faire émerger des émotions spontanées qui échappent aussi bien au créateur qu’au spectateur. « J’avais envie d’évoquer la question de la mémoire retrouvée après un traumatisme, qui témoigne du désir de vivre », explique Yves Robert. Qui se dit surpris des réactions du public : « Après les rires et même les larmes des spectateurs, ceux-ci m’ont parlé de la force des émotions que le texte avait révélées. »
Un drame de la montagne a inspiré Yves Robert: il y a quelques années, un alpiniste a perdu la vie à la suite d’une chute. Il grimpait avec une amie qui, elle, a survécu. L’auteur imagine le réveil de cette femme gravement blessée qui attend les secours, aux côtés du cadavre. Elle se sent responsable, même si l’enquête conclura à l’accident.
Dans un premier temps, sa mémoire refuse la réalité. Son inconscient, sa morale, son éthique prennent, dans le récit, la forme d’un chocard persifleur, qui l’interroge, la forçant à affronter la réalité pour aller au-delà de son amnésie.
Par besoin d’expérimentation, Robert a monté une lecture-spectacle. La femme, Laurence Iseli et l’oiseau sardonique, Blaise Froidevaux, s’affrontent dans un duel inégal, d’une grande sobriété. Réduit au minimum, le décor souligne la poésie du texte, sa simplicité, que pas un mot de trop n’encombre. Un grand moment d’émotion à ne manquer sous aucun prétexte.
Bernadette Richard

A 3000 mètres d’altitude, une alpiniste fracassée ne se remet pas d’une chute et d’une perte incommensurable dont le souvenir ne lui revient pas. «Journal du silence» aborde la mémoire perdue et que l’on retrouve. Avant d’explorer un deuxième volet en cours d’écriture, la perte de cette même mémoire. L’homme est écrivain de l’errance et de la force du vide. Que l’on se souvienne ici de la Ligne obscure filant une réflexion sur le personnage et l’écriture même. Là du Livre des tempêtes tout en théâtre intérieur. Ou de La Rivière à la mer dépliant les splendeurs et misères volontiers burlesques d’un être à la dérive.
Yves Robert est parti pour l’écriture de son Journal du silence d‘une amnésie traumatique dont souffre une femme immobile dans la neige. Et de se faire le sismographe de l’effort tour à tour désespéré, poétique et un brin philosophique de cet être blessé à l’esprit comme au corps de reconstituer sa mémoire. Et donc son identité.
La vie diminuée est‐elle pire que la vie supprimée, effacée et scellée dans son linceul de givre suit à une maladresse, un pas de côté de cette compagne de cordée? Pour elle, un temps: «Il n’y avait que du silence, c’était rassurant, des mots perdus dans ma tête.» Avant de se remémorer in fine ce petit bal perdu qu’elle a vécu avec l’homme et la mort, l’accident sur le versant:
Le rouge éclatant de leurs pattes, reflets écarlates aux extrémités des ailes, soutenu par le doigt de l’irréel, par‐dessus les précipices, au‐ dessus des abîmes. L’élégance du monde voletant maladroitement… c’est simple, beau.
La femme mène ce travail laborieux de ressouvenance en compagnie d’un oiseau – imaginaire ou non, on ne sait trop – qui est un chocard à bec jaune. Immortalisé par les délicates aquarelles du peintre Samival, ce chouca est dans la nature prompt à narguer les alpinistes accrochés à leur paroi de ses vrilles et voltiges. Il fait aussi signe de réconfort alors que l’alpiniste se croit abandonnée de tous plongé dans le brouillard. Son vol pure est tout entier contenu dans les lignes estampées par l’écrivain de la Tchaux et passée par la femme accidentée:
Le rouge éclatant de leurs pattes, reflets écarlates aux extrémités des ailes, soutenu par le doigt de l’irréel, par‐dessus les précipices, au‐ dessus des abîmes. L’élégance du monde voletant maladroitement… c’est simple, beau.
D’où l’envie de s’interroger sur la part d’action volontaire dans la disparition de la mémoire. Ainsi des événements et situations que l’on préfère ne pas se remémorer. Car bien trop douloureux. Si la douleur n’irradie encore moins n’existe au début la pièce, la fin montre la femme habitée d’une profonde connaissance de sa souffrance qui sonne comme une reconnaissance. Avec comme corollaire, «l’acceptation de la ruine du corps», souligne l’auteur en entretien. Qui met en scène son texte à deux interprètes, Laurence Iseli et Blaise Froidevaux dans une fidélité tendue au verbe incarné par un jeu voulu épuré et précis. Et une économie de moyens.
L’opus arpente aussi la reconnaissance ou non de l’irréel, interroge sur ce qu’une femme attend d’un homme. Et soupèse l’acception des rugosités entre l’homme et la femme à partir du moment où un parcours commun est empaumé, vécu, fait autant que défait par les nuits et les jours. Sommes‐nous faits de poussière d’étoiles alors que 97% de nos milliards de milliards d’atomes sont issus du cosmos? C’est l’énigme de la montagne qui n’est «ni cruelle ni aimante». Pourquoi dès lors s’acharner à donner un sens à ce qui n’en a pas? Être une femme de passions et d’émotions plutôt que de curiosité, voici l’une des voies tracées par ce Journal du silence.
Bertrand Tappolet

Sous la direction du comédien Blaise Froidevaux, l’écrivain et homme de théâtre Yves Robert donne en lecture La Rivière à la mer en fond de cale de son Atelier Grand Cargo. Cette tanière artistique, il l’a créée au cœur de l’Esplanade, un quartier «populaire surgi dans les années 90 avec des logements sociaux». Le lieu accueille ses écritures et mises en scènes ainsi que photographes ou peintres exposés, agapes littéraires et concerts.
A la source de l’Atelier, la réflexion suivante: «Travailler un spectacle, monter une production est une chose compliquée. Chaux-de-fonds n’est pas riche en adresses de spectacles avec ses deux structures principales, L’Heure Bleue-TPR et le Théâtre ABC intensément occupées. Disposer de temps et d’espace de répétition en devient un luxe.» D’où quelque chose, à une échelle bien plus modeste, du rêve de Brecht imaginant les représentations telles des respirations publiques au cœur d’un travail continu alliant écriture, essais, tâtonnements, recherches et répétitions. Il fallait oser ce site singulier en Suisse romande cultivant la modestie spatiale avec ses 35 places. «La vitesse de croisière d’un spectacle se trouve au fil des séances et de l’apprentissage de l’écoute du public», souligne le maître des lieux. L’infrastructure culturelle est financée par des mécènes et des privés extra-cantonaux, les subventionnements locaux étant destinés, eux, à la création.
Ceux qui suivent Yves Robert savent le plaisir qu’il prend à jouer avec les limites de la narration. Sa Rivière à la mer ne déroge pas à la règle. Cet écrivain de l’errance n’hésite pas à casser la chronologie, à l’émailler de flash- back ou de sauts dans le temps manière d’évoquer, de restaurer, mais aussi de reconstruire une mémoire défaillante. La vie est là, s’offrant et se retirant, comme la mer, pénétrante, tour à tour lointaine et familière. En témoigne aussi son récit La Ligne obscure, arpentage de la notion de personnage entre animalité originelle et barbarie mythologique ainsi que réflexion sur l’art de la fiction. Et sa pièce, Lieutenant de guerre. Elle dévoile un SDF tenter un improbable dialogue avec une femme posée derrière son entrée. «Vous devrez écraser mes mots, les réduire au silence. Si vous voulez refermer cette porte», dit- il.
«À quoi bon regretter ce qui ne s’explique pas», confie l’auteur sur la mort du père. Le constat vaut pour la tante atteinte de démence sénile ou d’Alzheimer. A quel point-sommes- nous portés par l’absence d’êtres toujours en vie, mais sans plus d’accès au monde, réfugiés dans une forme de blancheur qui se confond avec l’effacement de soi. La mémoire de la tante «morte avant d’être morte» est ce «cerveau en paysage lisse. Un horizon toujours recommencé.» La maladie d’Alzheimer est un paysage blanc qui touche la personne qui ne peut s’en extraire. Elle «affecte l’individu sans qu’il puisse s’en réveiller. Il a mené à son terme la disparition de soi et n’a plus de comptes à rendre à un monde qu’il ne comprend plus ou ne veut plus comprendre», relève l’anthropologue David Le Breton.
Le récit évoque notamment la mise en détention de Pinochet en Angleterre et la sinistre Opération Condor, cam- pagne d’assassinats et de répression touchant n’importe quel «dissident potentiel et ses proches» conduite par les services secrets chiliens, argentins, boliviens, brésiliens, paraguayens et uruguayen, de 1975 à 1983 avec le soutien des États-Unis. «Le plan Condor, des milliers de disparus. Des femmes, des hommes nus, tremblants. Balancés depuis les hélicoptères au large des mers australes. Éventrés vivants à coups de couteau. Un cadavre percé ne flotte pas», écrit Yves Robert relativement aux «vols de la mort» effectués au Chili et en Argentine. Ces faits historiques recoupent une interrogation essentielle: «Combien de naissances pour être un homme?» Ce thème des naissances multiples vient de la chanson de Dylan, Blowing in the Wind et son «how many times», comme dans «Combien de fois un homme doit-il lever les yeux/Avant de voir le ciel?» L’auteur considère ainsi que chaque événement qui nous constitue – avec sa prise de conscience sur notre état d’existence – est une naissance.
«Lui, il regarde le visage fermé de son père et s’interroge. Il ressent de l’agacement à le voir s’accrocher. Un curieux mélange. Il ne sait pas com- ment dire adieu. Qui peut le savoir?», entend-on dans La Rivière à la mer. L’enterrement permet alors de saisir qu’à la disparition du père, le fils peut devenir son rêve. En entretien, le dramaturge tient à préciser: «S’imaginer que notre existence n’est valable que par le rêve des trépassés est une forme d’abstraction, de réinvention de notre réalité en partant du regard prêté au mort. Mais il ne s’agit pas d’accomplir les rêves inachevés de mon père».
On suit ce travail de déduction, d’imagination qu’il faut réaliser pour que les vivants répondent aux morts, les présents aux absents: le décès du grand- père – «un vieux monsieur avec une canne, un chapeau et un sourire de fonctionnaire postal à la retraite» – en ses dimensions parfois burlesques constitue le cœur de cet ensemble, la pierre angulaire du récit. Comme souvent chez l’écrivain, le rire se dissimule dans la gravité. Ainsi la mort subite du pasteur devant prononcer l’oraison funèbre du grand-père, la veille de celle-ci. Narré avec une cinglante concision, l’épisode incongru scande la première compréhension de la mort en sa dimension tragicomique chez l’enfant de La Rivière à la mer. ■
Bertrand Tappolet

En janvier dernier, Yves Robert et les comédiens de la Cie Fantôme ont investi «Le Labo», la salle de répétition du Centre de culture ABC à La Chaux-de-Fonds. Avec, sous le bras, les trois premières scènes d’une pièce, «L’esquisse, ou Delphine et le rhinocéros», élaborée ensuite au fur et à mesure des répétitions, échelonnées sur six mois. De retour à l’ABC, l’équipe boucle ce week-end la dernière étape de cette écriture théâtrale «in progress», qui a bouté l’auteur hors de son champ théorique pour le propulser dans le champ pratique! Demain, une ultime lecture se déroulera «dans la plus grande simplicité», juste soutenue par quelques ambiances sonores. Laissant, donc, libre cours à l’imagination du spectateur, aiguillonnée par un rhinocéros polyglotte!
«J’ai expérimenté un outil de fabrication théâtrale extraordinaire», s’enthousiasme Yves Robert. «Quand j’ai entamé le travail, je connaissais déjà la fin de la pièce, et les thèmes que je voulais traiter. Mais je ne savais pas par quel chemin on y arriverait.»
Projetés tantôt dans la véranda d’un jardin tantôt dans la savane africaine, auteur et comédiens – Christine Chalard, Samuel Grilli, Jacint Margarit et Laurence Sambin – ont progressé ensemble dans cette histoire qui brasse les souvenirs et avive la douleur, où le passé et le présent se court-circuitent pour créer un paradoxe temporel. Ils ont partagé cette expérimentation avec le public, convié à suivre certaines répétitions puis aux lectures du travail en cours – celles-ci ont attiré entre cinq et 30 curieux, selon les lieux où l’équipe a creusé son sillon. «Nous avons aussi sollicité deux intervenants, Nathalie Sandoz, actrice et metteure en scène, et Julien Annoni, percussionniste.» Autant de regards extérieurs qui se sont avérés stimulants, apprécie l’auteur.
Il ne mettra pas, cette fois-ci, lui-même en scène cette histoire, celle d’une jeune femme amenée à faire le deuil de son grand-père, traitée avec plus de drôlerie que de pathos. Frustrant de s’arrêter ainsi au seuil de la représentation? «Absolument pas, car nous avons créé ‘L’esquisse’ pour qu’un tiers s’en empare: je conçois cette appropriation comme un enrichissement, non un viol!»
Dominique Bosshard

L’Impartial – A la dérobée
Après les enfants, c’est au tour des grands d’avoir classe avec la Cie Fantôme.
A l’ABC, l’école fait son théâtre
Quand la compagnie Fantôme fait la classe, ça déménage! Le public a école dès demain soir au théâtre ABC, à La Chaux-de-Fonds, avec une instit lunaire, passablement allumée: la comédienne Christine Chalard. Sa leçon, d’une durée de 45 minutes, elle l’a rodée «pour de vrai» dans les classes primaires du Locle lors de représentations scolaires. C’est toutefois aussi à un public d’adultes que s’adresse ce spectacle aux multiples lectures, articulé autour des premiers émois amoureux, de la transgression et de la liberté… Des thèmes complexes pour un jeune public? Yves Robert, auteur et metteur en scène, en rigole: «Les enfants aussi peuvent éprouver des sentiments amoureux, de la jalousie. Eux aussi se demandent quels sont les mots et les gestes justes à adopter. Je fais confiance aux spectateurs, surtout aux plus jeunes d’entre eux.»
Poupées russes
L’homme de théâtre chaux-de-fonnier est un conteur: «J’aime entraîner le public dans des histoires qui s’emboîtent comme des poupées russes. Le but du spectacle n’est pas d’expliquer, mais de raconter…»
Tout commence «A la dérobée», titre de la pièce, avec l’arrivée impromptue d’une enseignante pas très académique. Chargée de remplacer la remplaçante d’un improbable professeur Schnitzel, la loufoque pédagogue s’échappe des règles imposées. Et parle aux élèves de la cité de Pompéi, du «Baiser à la dérobée» du peintre Fragonard, de son premier amour à elle. Tout est prétexte à colorier, à chamarrer le tableau noir.
Yves Robert aurait-il quelques comptes à régler avec l’institution scolaire? Même pas! «J’ai eu une scolarité semi-heureuse. Et si tous mes spectacles devaient être autobiographiques, je n’aurais pas survécu. D’ailleurs, mon héroïne ne fait pas de la pédagogie, elle joue du théâtre avec le plus de plaisir possible. Elle propose simplement à son auditoire un voyage, le temps d’une leçon; puis s’en va, laissant flotter derrière elle un parfum de rose, un souvenir.»
Lors des représentations scolaires, les directeurs de collèges jouent complètement le jeu en avisant les élèves par une circulaire de la venue d’une remplaçante. A l’ABC, les grands aussi auront droit à leur leçon pour de vrai. Mais Yves Robert n’en dira pas plus, suspense oblige. Le spectacle devrait partir ensuite en tournée dans d’autres écoles du canton. Néanmoins, que les parents et pédagogues se rassurent: par quelques astuces scéniques et une rencontre avec les élèves à la fin de la re- présentation, la frontière entre fiction et réalité est clairement balisée: «Il est nécessaire de démystifier les transgressions, de montrer la différence entre la vraie vie et le théâtre.»
Message bien reçu: «Dans les classes du Locle, tout le monde se marrait, les profs comme les élèves! A la fin, une fillette a eu cette réaction: «On n’a rien appris pendant cette leçon, faudra le dire à la direction!»
CATHERINE FAVRE

L’Impartial
Champagne et caviar, le bateau coule!
Ils sont riches mais ont tout à perdre, ils n’ont rien et font croire qu’ils ont tout. Les voici embarqués dans «Pauvres riches», une comédie à déguster ce week-end à La Chaux-de-Fonds. Des dialogues, courts, vifs. Le plaisir du jeu, de la relance, tel que peut l’offrir une comédie basée sur les quiproquos. Dans le parcours de la Cie Fantôme, «Pauvres riches» apparaît comme une respiration, une évasion dans la légèreté des bulles de champagne et des grains de caviar. Une gourmandise, à partager ce week-end au Temple allemand à La Chaux-de-Fonds.
Seule en scène, Christine Chalard était «La femme qui tenait un homme en laisse», un monologue d’Yves Robert inspiré par la soldate américaine Lynndie England, que les humiliations infligées aux prisonniers d’Abou Ghraïb rendirent tristement célèbre. La voici dans la peau de Pétula, une parvenue imaginée par le même Yves Robert, la plume de la compagnie chaux-de-fonnière qu’ils animent ensemble. «Je suis prolixe en écriture», explique l’auteur; «la structure de la pièce est établie dès le départ, mais le matériau reste assez large.» Et malléable donc, car la compagnie et son complice Julien Barroche, metteur en scène, conçoivent le spectacle comme un art vivant, et non comme une vitrine pour exhiber leur ego.
Amaigrie au fil des séances de travail, la version «finale» de «Pauvres riches» s’amuse de la rencontre fortuite entre deux couples. Tombés en panne alors que la tempête fait rage, Pétula et son riche mari (Philippe Vuilleumier) s’abritent dans la demeure d’un couple d’aristocrates (Olivia Seigne et Thierry Romanens). Mais les apparences peuvent être trompeuses, et rapides les renversements de situation…
«Les personnages se profilent comme des archétypes, mais ils ont un passé, donc une humanité», commente Yves Robert. «On mélange les genres, on est proche de la comédie, du boulevard, voire même du théâtre de salon. Rompu à l’humour du café-théâtre, Thierry Romanens permet de jouer sur ce registre-là aussi.»
L’auteur, qui, souligne-t-il, avait choisi sa thématique avant que la crise n’éclate, avoue une autre référence, celle de la comédie américaine et, plus précisément, de Frank Capra. Attentif aux rapports sociaux et à la marche de notre monde, Yves Robert penche davantage du côté des valeurs défendues par le cinéaste – modestie, intégrité, solidarité – que vers le cynisme ambiant. «La pièce s’achemine donc vers un happy end, mais un happy end conditionnel, comme en sursis. Car on comprend que ces idéaux, aujourd’hui, ne se suffisent plus à eux-mêmes».
Pour autant, ces «Pauvres riches» n’ont pas pour vocation de donner une leçon, promet l’auteur. «Cela reste un divertissement même si, au-delà du rire, il est permis de se poser quelques questions.»
Dominique Bosshard

Yves Robert raconte le voyage houleux vers un choix d’humanité
«Le livre des tempêtes», pièce du Chaux-de-Fonnier Yves Robert, sera vendredi et samedi au théâtre du Pommier, à Neuchâtel. Sur fond historique, un travail sur la mémoire et son influence sur le cheminement vers la conscience.
«J’aime utiliser l’Histoire comme décor. Cela permet de faire évoluer les personnages, de les soumettre à des pressions qu’on ne trouve pas forcément d’ordinaire». L’auteur et dramaturge Yves Robert signe en effet une troisième pièce, «Le livre des tempêtes», dont le personnage central traverse une période houleuse de l’Histoire, de la guerre civile en Sibérie à la 2e Guerre mondiale. Mise en scène par Julien Barroche, elle sera interprétée par la compagnie valaisanne Gaspard vendredi et samedi, au théâtre du Pommier à Neuchâtel.
Créée en septembre à Sion, la pièce «Le livre des tempêtes» s’est écrite dans une optique d’échange avec la compagnie Gaspard et le metteur en scène. «C’était un peu un travail de ping-pong. Je présentais mes textes de façon régulière à la compagnie. J’avais ainsi accès à de premières réactions, et je pouvais aussi nourrir mon texte par rapport à la voix des acteurs», raconte Yves Robert. «Mais l’écriture est restée mon domaine».
Une forme d’écriture théâtrale que l’auteur Philippe Renaud dans sa postface du «Livre des tempêtes» rapproche plus du roman, du conte. Chez Yves Robert, point d’actes ou de scènes, mais des parties titrées. «Je suis tout à fait d’accord avec Philippe Renaud. Pour moi, le théâtre n’est pas un système cloisonné, avec des justes et des faux: ce sont des expressions différentes. A partir du moment où on est sur scène avec du verbe et de l’action, c’est du théâtre». Le style est lui empreint de poésie: «Les étoiles se sont brisées, du verre scintillant, éparpillé». Un principe auquel tient Yves Robert: «Par la poésie, j’ouvre des images incomplètes, comme si je donnais au spectateur des grilles de mots croisés à moitié remplies. Cela le rend attentif et déductif».
L’histoire, elle, est construite autour d’Edgar, le personnage principal, «un homme banal qui traverse une période extraordinaire», commente Yves Robert. La pièce suit sa trajectoire au fil de ses rencontres, de ses déplacements de Sibérie en Chine, en Allemagne puis en France. Avec en toile de fond, la montée du nazisme. «Edgar devient un personnage amoral. Il vit dans l’insouciance, dans une collaboration de la tranquillité», explique l’auteur. Jusqu’à un point de non-retour, où cette insouciance infantile fait place à une prise de conscience d’adulte. «Il me fallait un moment historique cataclysmique comme l’automne de 1941, où l’Allemagne est toute puissante, pour l’amener à un choix. Et il fait un choix d’humanité».
Mais ce n’est là que l’une des lectures possibles du «Livre des tempêtes». Au thème de la mémoire s’adjoint par exemple celui du livre en soi. Il est lui aussi un vecteur de la mémoire, collective ou personnelle, ce qu’Edgar découvre peu à peu. «Mais il y a aussi la transmission par le spectacle», note Yves Robert. Dans la pièce, Edgar possède lui-même un livre des tempêtes. Mais il n’écrit pas son histoire: les pages restent blanches. «C’est au spectateur de transcrire et de transmettre l’histoire», conclut Yves Robert. /ANC

L’Hebdo
Tragédie réelle.
Août 2004. Une photographie fait le tour de la planète. Sur le cliché, une jeune femme soldat américaine avec une laisse. Au bout de la corde, un prisonnier irakien nu, humilié, rampant sous les ordres de son bourreau. Le monde est attérré. On parle alors du scandale d’Abou Ghraïb. Le neuchâtelois Yves Robert en fait un monologue puissant, creusant au-delà le “news CNN”, et tentant de recomposer les blessures, les manques, les frustatrations derrière le “fait divers”, avec toutes ses nuances et ses aspérités. Loin du politiquement correct, le spectacle – tout de sobriété et interprété magnifiquement par Christine Chalard-Mühlemann, mise en scène par Julien Barroche – est une pure merveille de justesse, d’intelligence et d’humanité.
Anne-Sylvie Sprenger

24 heures
Une fiction brillamment écrite par Yves Robert, sobrement mise en scène par Julien Barroche et, surtout, magistralement interprétée par Christine Chalard-Mülhemann. Une comédienne capable de décliner une multitude d’émotions avec une justesse aussi rare qu’infaillible. Un pari largement relevé tant l’on ressort de cette pièce ébranlé.
Raphaël Muriset

Une traversée. Des rencontres insolites. Alice aux pays des insectes. De la malice, de la gouaille, du rythme, de petites inquiétudes comme des spasmes, du rêve. Un gobelet de glace citron à la main, un sourire sur les lèvres, une émotion perceptible sur la rétine. On ressort ému, samedi matin à La Chaux-de-Fonds, fier d’avoir partagé un fragment de vie. «Madame Bouh», présenté devant une salle Faller archicomble, enchante par l’audace des sentiments crus et nobles véhiculés par Yves Robert.
L’auteur réussit la prouesse de provoquer fantasme et dégoût avec un texte littéraire que les plus jeunes peuvent approcher mélodiquement. On y découvre: «Un homard arboricole, un hérisson avec un mikado sur le dos, une lasagne aux vieilles chaussettes.» La jeune Delphine Courage explique au phasme timide que tout ce qu’il risque en abordant un Dame c’est «un premier baiser».
La douceur et la «saudade», cette mélancolie du Portugal que le français peine à exprimer, irriguent chaque instant de ce spectacle. Le compositeur Claude Berset propose une déconstruction savante qui séduit en inventant. Comme une roulade au citron de notes qui finissent par nous envelopper par la virtuosité communicative de la pianiste Mireille Bellenot et des flûtistes Enza Pintaudi et Helga Loosli. Les trois musiciennes partagent aussi leurs émotions avec les mots et recherchent la complicité du public avec talent.
La mise en scène de Muriel Matile frappe par sa sensualité, son envie de partage, sa fragilité mutine qui sait regrouper ce magma de talent. On regarde la comédienne Christine Chalard-Mühlemann comme une petite fille à la langue bien pendue.
Mais la performance de la comédienne ne se limite pas à jouer l’enfance, elle descend très profond en elle pour trouver l’expression juste. Les costumes inventifs et décalés de Geneviève Petermann et Bernard Jaques ponctuent ce moment de régal.
Alexandre Caldara – L’Impartial le 13 mars 2007

24 heures – La femme qui tenait un homme en laisse
Au-delà de la news CNN
Au Pulloff se joue La femme qui tenait un homme en laisse, un monologue d’une justesse exceptionnelle.
Une photographie fait le tour de la planète. Le monde est atterré, les journalistes et les officiels de tous bords hurlent au scandale. Sur le cliché, une jeune femme soldat américaine avec une laisse. Au bout de la corde, un prisonnier irakien nu, humilié, rampant sous les ordres de son bourreau. Qui n’a pas entendu parler deces photos prises dans les couloirs de la prison d’Abou Ghraïb ?
Ces jours au Pulloff, se joue La femme qui tenait un homme en laisse, un monologue du Neuchâtelois Yves Robert inspiré par cette triste affaire de barbarie gratuite. Réactif d’abord – le choc, l’indignation, l’incompréhension, – le texte utilise les codes de la fiction pour creuser au-delà de la news CNN, chercher à recomposer les blessures, les manques, les frustrations qui composent l’histoire personnelle derrière le «fait divers», avec tous ses nuances et ses aspérités. Sans jamais condamner ni justifier.
Sur scène, l’ambiguïté prend toute son ampleur. Le spectacle que l’on craignait politique correct est une pure merveille de justesse, d’intelligence et d’humanité.
Une banquette de salle d’attente pour tout décor et une caméra. Dispositif sobre et puissant dans l’évocation. Sous la direction de Julien Barroche, la comédienne Christine Chalard-Mühlemann – magnifique – trace avec force et dualité la vie imaginée de Lynndie England. Caméra en main ou sur trépied, la comédienne livre une douloureuse et intime plaidoirie, qui passe des rires arrogants aux larmes étouffées, en passant par la joyeuse naïveté d’une adolescente qui croit agir pour son pays. En filigrane, se dessine toute l’histoire du peuple américain et de ce foutu rêve de réussite qui devient trop lourd à porter quand on a grandi dans une petite ville perdue de l’Oklahoma.
Défilent alors les images aigres, malgré ses envies de douceur, d’une vie qui a tourné du côté de l’horreur et de la cruauté, un jour, dans une prison près de Bagdad. Et ce, dans la plus grande bonne foi, C’est là, la vraie tragédie
Anne-Sylvie Sprenger

L’Impartial – La femme qui tenait un homme en laisse
Le mauvais rêve américain
Une fiction? Certainement, l’auteur l’affirme. Néanmoins «La femme qui tenait un homme en laisse…» est un texte aussi essentiel qu’un souffle, aussi sincère qu’un cri. Yves Robert a pris le temps de réfléchir, d’imaginer, d’écrire. Vendredi au théâtre ABC, à La Chauxde-Fonds, la comédienne Christine Chalard a joué le rôle de Lynndie England, cette Américaine qui dans les prisons d’Abou Ghraïb a fait subir des humiliations à des détenus irakiens.
La voix du muezzin
Yves Robert plonge à cœur perdu dans l’indignation, dans la volonté de secouer la somnolence planant sur la guerre, d’appeler au secours. Il suit les méandres par lesquels la jeune femme a passé jusqu’à exorciser sa propre douleur dans le malheur des autres, jusqu’à se laisser submerger par la haine, la cruauté, puis par la honte. Yves Robert survole l’histoire contemporaine des Etats-Unis, on retrouve quantité de données édifiantes: crise de 1929, 1945, Vietman, ségrégation raciale, pratiques militaires. Il imagine l’enfance triste de Lynndie, en Oklahoma, dans une famille d’origine européenne. Et, plus tard, son engagement à l’armée, le départ en Irak, l’intégration à la «nouvelle unité pour la prison d’Abou Ghraïb»
Ethnographie et fiction
Petit à petit il attire l’attention de Lynndie England sur des mots qu’elle ne connaît pas: Mésopotamie, berceau de quelle civilisation? L’Euphrate, les minarets? Autant de scuds en puissance… Pourtant elle est touchée par la voix du muezzin. Cette soudaine sensibilité relèverait-elle de quelque rédemption? Elle ouvre certainement un espace où va se déployer la plus inédite des dramaturgies. L’ethnographie rejoint la fiction. La mise en scène est de Julien Barroche, la scénographie de Nicole Grédy. Le jeu de Christine Chalard est attachant. La jeune comédienne, en pleine ascension, rend la personnalité de Lynndie jusqu’au bout de chaque mot, de chaque geste.
D e n i s e d e C e u n i n c k

L’Impartial – La mort de Vladimir
Attention objet théâtral non identifié ! envoûté par l’extraordinaire pouvoir d’évocation d’une écriture servie par une mise en scène à la fois sobre et vibrante de sensibilité, le chroniqueur ne peut que s’incliner.
Certes, la démarche d’Yves Robert est exigeante. Un cours d’histoire du 20ème siècle, en une heure et quart, et au théâtre de surcroît, voilà à priori de quoi décourager le spectateur ! Il aurait tort pourtant. Car cette pièce dont quatre représentations ont été données à l’ABC la semaine dernière, n’est pas un cours ex cathedra. Elle est faîte de chair et de sang, de rire et de larmes, d’amour de l’humain malgré tout, malgré ce siècle d’horreur sans fin, de la révolution russe à la guerre d’Irak, en passant par Hitler, Hiroshima – et Dresde, qui n’ose se dire martyre, car ville d’un peuple entier confondu avec le régime bourreau.
Un rire vital
Dans ce fourmillement d’avanies, de petitesses, de grands massacres, un être se lève : Vladimir, personnage de fiction que deux comédiens s’attachent à nous rendre réel. Il finira comme chacun d’entre nous, par rendre son dernier soupir, mais en un lieu et des circonstances dont il ne faut rien dévoiler, sinon pour dire, peut-être, qu’ils portent la marque d’une tendre dérision et d’une fugace espérance. La vie, c’est le rire de Vladimir, cet improbable fils d’un siècle gavé de sang, qui éclate, vital à la face du monde.
Les acteurs, Christine Chalard-Mühlemann et Samuel Grilli, servent avec ce qu’il faut de recul et d’engagement ce texte magnifique et dense qui fourmille de trouvailles narratives et de pieds de nez au destin.
Au bout du compte, au lieu d’être assommé, on ressort gonflé à bloc et rempli d’une certaine tendresse.
Léo Bysaeth